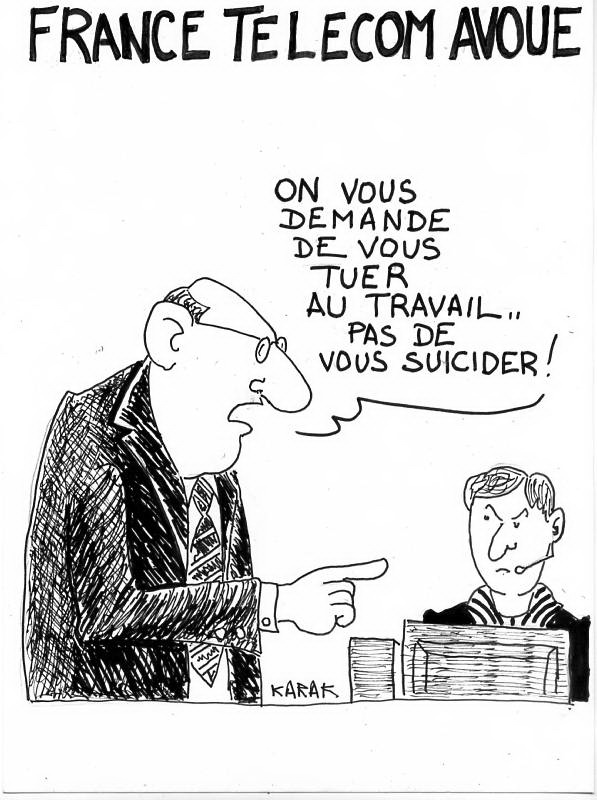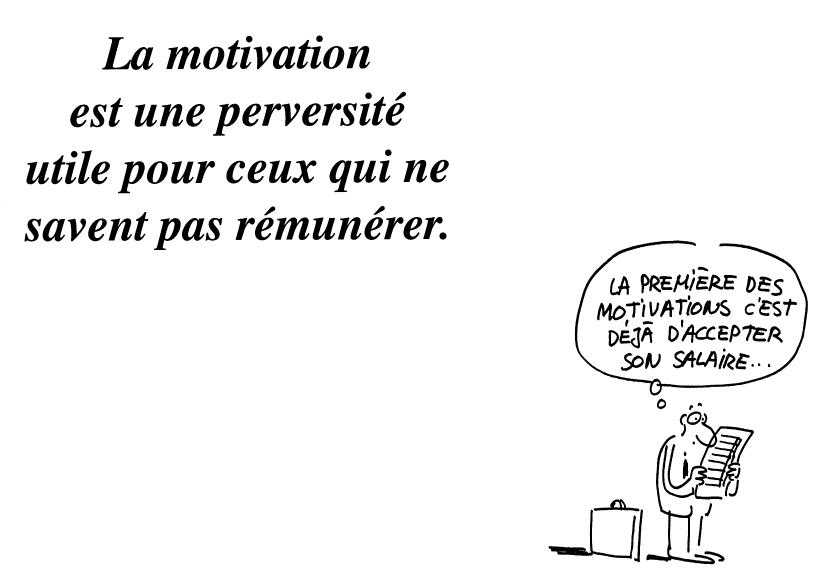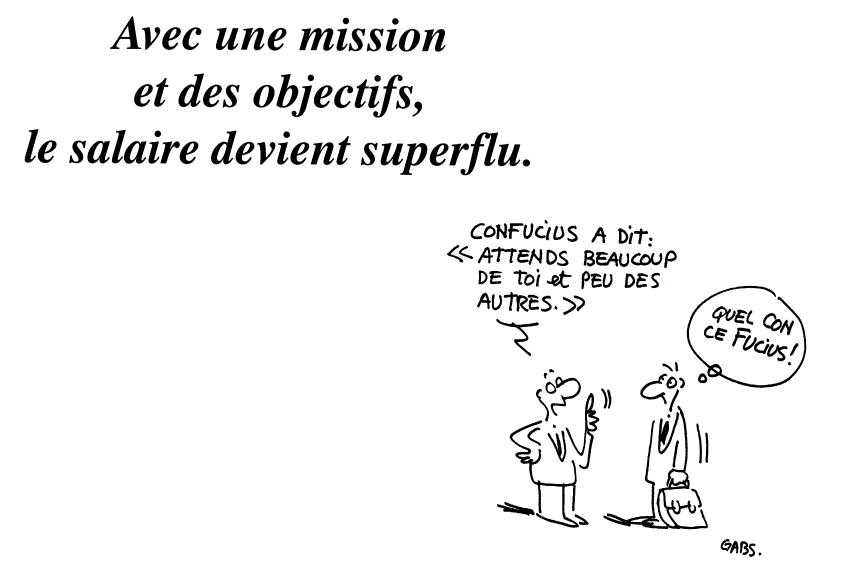Si vous n’avez pas lu cet article du monde, je vous le recommande.
 | 02.04.11 | 15h11 • Mis à jour le 04.04.11 | 15h39
| 02.04.11 | 15h11 • Mis à jour le 04.04.11 | 15h39
Une information fondamentale publiée par l’Agence internationale de l’énergie (AIE) est passée totalement inaperçue : le pic pétrolier s’est produit en 2006. Alors que la demande mondiale continuera à croître avec la montée en puissance des pays émergents (Chine, Inde et Brésil), la production de pétrole conventionnel va connaître un déclin inexorable après avoir plafonné. La crise économique masque pour l’heure cette réalité.
Mais elle obérera tout retour de la croissance. La remontée des coûts d’exploration-production fera naître des tensions extrêmement vives. L’exploitation du charbon et des réserves fossiles non conventionnelles exigera des investissements lourds et progressifs qui ne permettront guère de desserrer l’étau des prix à un horizon de temps proche. Les prix de l’énergie ne peuvent ainsi que s’affoler.
Le silence et l’ignorance d’une grande partie de la classe politique sur ce sujet ne sont guère plus rassurants. Et cela sans tenir compte du fait que nous aurons relâché et continuerons à dissiper dans l’atmosphère le dioxyde de carbone stocké pendant des millénaires… Chocs pétroliers à répétition jusqu’à l’effondrement et péril climatique. Voilà donc ce que nous préparent les tenants des stratégies de l’aveuglement. La catastrophe de Fukushima alourdira encore la donne énergétique.
De telles remarques génèrent souvent de grands malentendus. Les objections diagnostiquent et dénoncent aussitôt les prophètes de malheur comme le symptôme d’une société sur le déclin, qui ne croit plus au progrès. Ces stratégies de l’aveuglement sont absurdes. Affirmer que notre époque est caractérisée par une “épistémophobie” ou la recherche du risque zéro est une grave erreur d’analyse, elle éclipse derrière des réactions aux processus d’adaptation la cause du bouleversement.
Ce qui change radicalement la donne, c’est que notre vulnérabilité est désormais issue de l’incroyable étendue de notre puissance. L'”indisponible” à l’action des hommes, le tiers intouchable, est désormais modifiable, soit par l’action collective (nos consommations cumulées) soit par un individu isolé (“biohackers”). Nos démocraties se retrouvent démunies face à deux aspects de ce que nous avons rendu disponible : l’atteinte aux mécanismes régulateurs de la biosphère et aux substrats biologiques de la condition humaine.
Cette situation fait apparaître “le spectre menaçant de la tyrannie” évoqué par le philosophe allemand Hans Jonas. Parce que nos démocraties n’auront pas été capables de se prémunir de leurs propres excès, elles risquent de basculer dans l’état d’exception et de céder aux dérives totalitaristes.
Prenons l’exemple de la controverse climatique. Comme le démontre la comparaison entre les études de l’historienne des sciences Naomi Oreskes avec celles du politologue Jules Boykoff, les évolutions du système médiatique jouent dans cette affaire un rôle majeur. Alors que la première ne répertoria aucune contestation directe de l’origine anthropique du réchauffement climatique dans les revues scientifiques peer reviewed (“à comité de lecture”), le second a constaté sur la période étudiée que 53 % des articles grand public de la presse américaine mettaient en doute les conclusions scientifiques.
Ce décalage s’explique par le remplacement du souci d’une information rigoureuse par une volonté de flatter le goût du spectacle. Les sujets scientifiques complexes sont traités de façon simpliste (pour ou contre). Ceci explique en partie les résultats de l’étude de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) pilotée par Daniel Boy sur les représentations sociales de l’effet de serre démontrant un sérieux décrochage du pourcentage de Français attribuant le dérèglement climatique aux activités humaines (65 % en 2010, contre 81 % en 2009). Ces dérives qui engendrent doute et scepticisme au sein de la population permettent aux dirigeants actuels, dont le manque de connaissance scientifique est alarmant, de justifier leur inaction.
Le sommet de Cancun a sauvé le processus de négociation en réussissant en outre à y intégrer les grands pays émergents. Mais des accords contraignants à la hauteur de l’objectif des seconds sont encore loin. S’il en est ainsi, c’est parce que les dirigeants de la planète (à l’exception notable de quelques-uns) ont décidé de nier les conclusions scientifiques pour se décharger de l’ampleur des responsabilités en jeu. Comment pourraient-ils à la fois croire en la catastrophe et ne rien faire, ou si peu, pour l’éviter ?
Enfermée dans le court terme des échéances électorales et dans le temps médiatique, la politique s’est peu à peu transformée en gestion des affaires courantes. Elle est devenue incapable de penser le temps long. Or la crise écologique renverse une perception du progrès où le temps joue en notre faveur. Parce que nous créons les moyens de l’appauvrissement de la vie sur terre et que nous nions la possibilité de la catastrophe, nous rendons celle-ci crédible.
Il est impossible de connaître le point de basculement définitif vers l’improbable ; en revanche, il est certain que le risque de le dépasser est inversement proportionnel à la rapidité de notre réaction. Nous ne pouvons attendre et tergiverser sur la controverse climatique jusqu’au point de basculement, le moment où la multiplication des désastres naturels dissipera ce qu’il reste de doute. Il sera alors trop tard. Lorsque les océans se seront réchauffés, nous n’aurons aucun moyen de les refroidir.
La démocratie sera la première victime de l’altération des conditions universelles d’existence que nous sommes en train de programmer. Les catastrophes écologiques qui se préparent à l’échelle mondiale dans un contexte de croissance démographique, les inégalités dues à la rareté locale de l’eau, la fin de l’énergie bon marché, la raréfaction de nombre de minéraux, la dégradation de la biodiversité, l’érosion et la dégradation des sols, les événements climatiques extrêmes… produiront les pires inégalités entre ceux qui auront les moyens de s’en protéger, pour un temps, et ceux qui les subiront. Elles ébranleront les équilibres géopolitiques et seront sources de conflits.
L’ampleur des catastrophes sociales qu’elles risquent d’engendrer a, par le passé, conduit à la disparition de sociétés entières. C’est, hélas, une réalité historique objective. A cela s’ajoutera le fait que des nouvelles technologies de plus en plus facilement accessibles fourniront des armes de destruction massive à la portée de toutes les bourses et des esprits les plus tourmentés.
Lorsque l’effondrement de l’espèce apparaîtra comme une possibilité envisageable, l’urgence n’aura que faire de nos processus, lents et complexes, de délibération. Pris de panique, l’Occident transgressera ses valeurs de liberté et de justice. Pour s’être heurtées aux limites physiques, les sociétés seront livrées à la violence des hommes. Nul ne peut contester a priori le risque que les démocraties cèdent sous de telles menaces.
Le stade ultime sera l’autodestruction de l’existence humaine, soit physiquement, soit par l’altération biologique. Le processus de convergence des nouvelles technologies donnera à l’individu un pouvoir monstrueux capable de faire naître des sous-espèces. C’est l’unité du genre humain qui sera atteinte. Il ne s’agit guère de l’avenir, il s’agit du présent. Le cyborg n’est déjà plus une figure de style cinématographique, mais une réalité de laboratoire, puisqu’il est devenu possible, grâce à des fonds publics, d’associer des cellules neuronales humaines à des dispositifs artificiels.
L’idéologie du progrès a mal tourné. Les inégalités planétaires actuelles auraient fait rougir de honte les concepteurs du projet moderne, Bacon, Descartes ou Hegel. A l’époque des Lumières, il n’existait aucune région du monde, en dehors des peuples vernaculaires, où la richesse moyenne par habitant aurait été le double d’une autre. Aujourd’hui, le ratio atteint 1 à 428 (entre le Zimbabwe et le Qatar).
Les échecs répétés des conférences de l’ONU montrent bien que nous sommes loin d’unir les nations contre la menace et de dépasser les intérêts immédiats et égoïstes des Etats comme des individus. Les enjeux, tant pour la gouvernance internationale et nationale que pour l’avenir macroéconomique, sont de nous libérer du culte de la compétitivité, de la croissance qui nous ronge et de la civilisation de la pauvreté dans le gaspillage.
Le nouveau paradigme doit émerger. Les outils conceptuels sont présents, que ce soit dans les précieux travaux du Britannique Tim Jackson ou dans ceux de la Prix Nobel d’économie 2009, l’Américaine Elinor Ostrom, ainsi que dans diverses initiatives de la société civile.
Nos démocraties doivent se restructurer, démocratiser la culture scientifique et maîtriser l’immédiateté qui contredit la prise en compte du temps long. Nous pouvons encore transformer la menace en promesse désirable et crédible. Mais si nous n’agissons pas promptement, c’est à la barbarie que nous sommes certains de nous exposer.
Pour cette raison, répondre à la crise écologique est un devoir moral absolu. Les ennemis de la démocratie sont ceux qui remettent à plus tard les réponses aux enjeux et défis de l’écologie.
Michel Rocard, ancien premier ministre, coauteur avec Alain Juppé de “La politique, telle qu’elle meurt de ne pas être” (JC Lattès, 314 p., 18 €).
Dominique Bourg, professeur à la faculté des géosciences et de l’environnement de l’université de Lausanne, membre du Comité de veille écologique de la Fondation Nicolas Hulot
Floran Augagneur, philosophe, enseigne la philosophie de l’écologie à l’Institut d’études politiques de Paris
Michel Rocard, Dominique Bourg et Floran Augagneur Article paru dans l’édition du 03.04.11